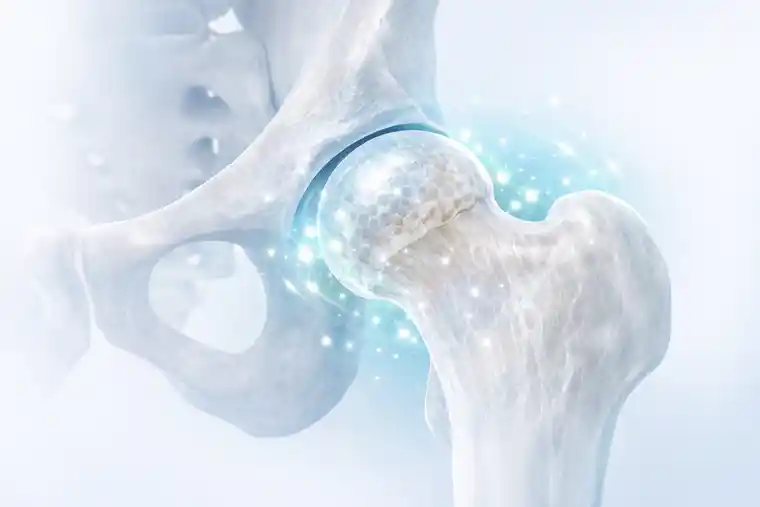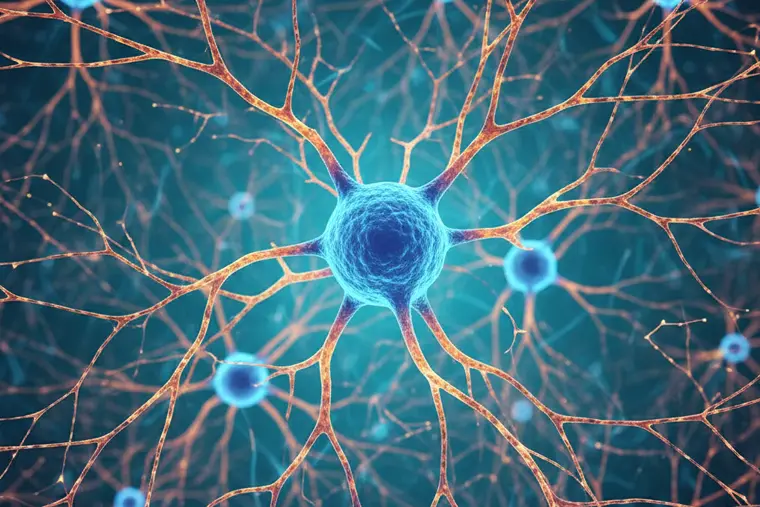Traitement par cellules souches et exosomes pour la paralysie cérébrale à Istanbul, Turquie – Perspectives du Prof. Dr Serdar Kabataş, MD, PhD(C)
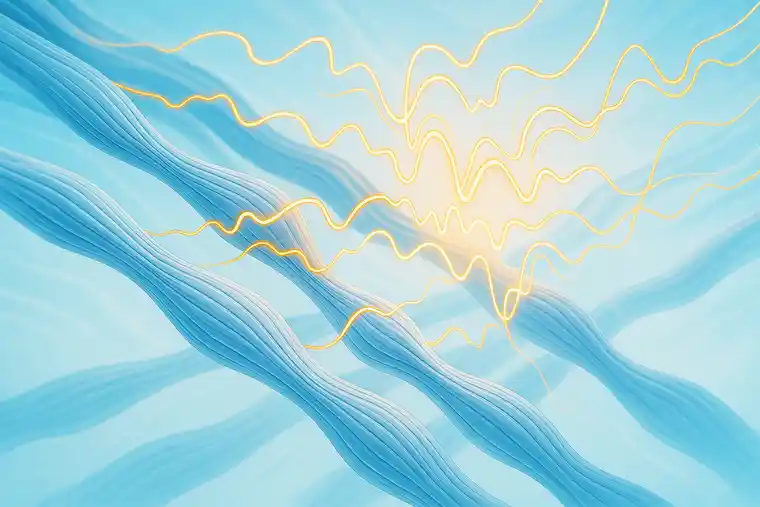
Comprendre la paralysie cérébrale et le rôle de la thérapie régénérative
Par le Prof. Dr Serdar Kabataş, MD, PhD (C)
Une perspective personnelle
Je suis le Prof. Dr. Serdar Kabataş, neurochirurgien, et je travaille depuis plus de vingt ans auprès de patients atteints de pathologies graves du cerveau et de la moelle épinière, allant des traumatismes et tumeurs aux troubles congénitaux chez les enfants. Au fil des ans, j’ai appris que la médecine est autant une question d’humilité que de compétences.
Quand j’ai commencé, je croyais que la précision et les longues heures de travail pouvaient résoudre presque tous les problèmes. Mais la médecine vous apprend qu’il n’en est rien. Vous découvrez que pour chaque patient que vous pouvez aider de manière spectaculaire, il y en a d’autres que vous ne pouvez aider que modestement, et parfois, ce peu signifie tout.
La paralysie cérébrale est l’une de ces maladies qui ne me quittent jamais l’esprit. J’ai vu des enfants grandir dans des salles de thérapie, des parents reconstruire leur vie autour de progrès lents et réguliers : quelques mots plus clairs, un petit pas qui semblait autrefois impossible.
C’est ce qui m’a conduit vers la médecine régénérative, en particulier les traitements à base de cellules souches et d’exosomes. Ils ne remplacent pas la rééducation, ils la prolongent.
Ils offrent au système nerveux quelque chose de rare : une seconde chance de se réorganiser, de se rétablir et parfois de nous surprendre. J’ai vu des enfants lutter contre un corps qui ne suit pas leur esprit, et des parents passer des nuits entières à chercher un moyen supplémentaire de les aider. La médecine traditionnelle nous a apporté la rééducation, la chirurgie et les médicaments, qui sont tous importants, mais elle atteint souvent ses limites.
C’est pourquoi je me suis tourné vers les traitements à base de cellules souches et désormais d’exosomes pour la CP : non pas pour promettre des miracles, mais pour ouvrir de nouvelles possibilités là où il n’y en avait aucune auparavant.
Table des matières
Ce que la paralysie cérébrale signifie réellement pour les familles
Lorsque les familles viennent me voir, la première chose que j’entends souvent, c’est le silence. Elles regardent leur enfant, puis moi, et quelque part entre les deux vient la question : « Les choses vont-elles s’améliorer un jour ? »
La paralysie cérébrale n’est pas une maladie unique ; c’est une histoire qui commence tôt, parfois avant la naissance, lorsque le cerveau en développement est endommagé. Les lésions ne s’étendent pas, mais les difficultés augmentent avec l’âge de l’enfant. Les muscles se raidissent, parler devient difficile, les petites tâches se transforment en longues leçons.
Au fil des ans, j’ai pu constater à quel point ces familles recèlent une grande force. Des mères qui apprennent toutes les thérapies par cœur, des pères qui soulèvent leurs enfants jour après jour sans se plaindre, des frères et sœurs qui grandissent trop vite. La paralysie cérébrale bouleverse la vie de toute une famille, pas seulement celle de l’enfant.
Où peut débuter la paralysie cérébrale – les « origines » en langage clair
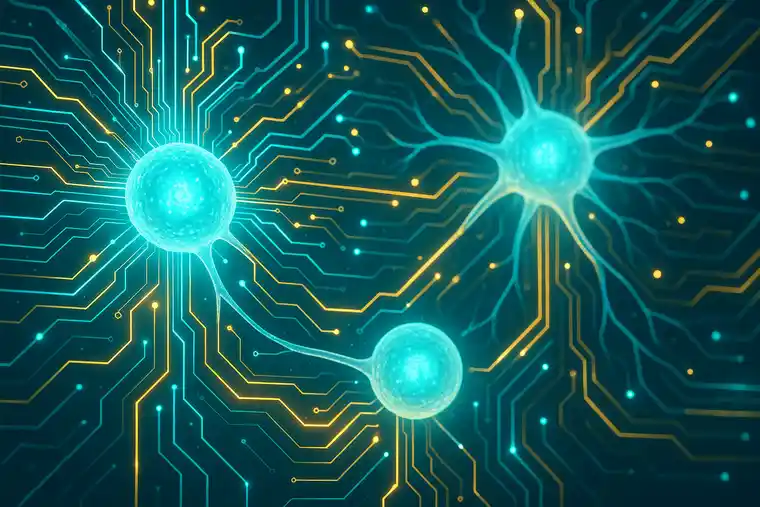
Lorsque j’explique les causes aux parents, j’essaie de retracer l’évolution de la paralysie cérébrale :
- Avant la naissance (prénatal) :
Problèmes liés au placenta, infections maternelles graves (par exemple, CMV, toxoplasmose), certaines maladies génétiques ou métaboliques, ou malformations pendant le développement du cerveau. Parfois, rien n’a été « mal fait » : le cerveau s’est simplement développé dans un état de stress. - Au moment de la naissance (périnatale) :
Manque d’oxygène/circulation sanguine pendant un accouchement difficile (lésion hypoxique-ischémique), naissance très prématurée avec matière blanche fragile (leucomalacie périventriculaire) ou hémorragie dans le cerveau du nouveau-né. Une jaunisse sévère (kernictère) peut également endommager les centres moteurs profonds. - Après la naissance (période postnatale précoce) :
Les infections graves (méningite, encéphalite), les accidents vasculaires cérébraux, les traumatismes crâniens ou les convulsions prolongées au cours des premiers mois peuvent entraîner des troubles moteurs permanents.
Très souvent, il n’y a pas une seule cause précise, mais plutôt un ensemble de risques. Et oui, chez de nombreux enfants, nous ne trouvons jamais d’explication parfaite. Cette incertitude peut être difficile à vivre, mais elle ne change en rien ce que nous pouvons faire ensuite.
Comment nous classons la paralysie cérébrale – et à quoi ressemble chaque type dans la vie réelle
Nous classons la PC en fonction du type de mouvement observé et des parties du corps les plus touchées. Les étiquettes nous aident à planifier la thérapie, mais elles ne remplacent jamais l’enfant qui se trouve devant nous.
1) CP de type spastique – « raideur qui vous combat »
C’est la forme la plus courante. Les signaux qui devraient détendre un muscle ne sont pas transmis correctement, de sorte que les muscles restent tendus et résistent au mouvement.
- Comment cela se manifeste : jambes en ciseaux, marche sur la pointe des pieds, coudes raides, amplitude limitée des hanches/genoux/chevilles. Les mouvements semblent difficiles, comme si le corps luttait contre ses propres freins.
- Où il se trouve :
- Diplegie spastique – jambes > bras (typique après une prématurité extrême).
- Hémiplégie spastique – un côté plus touché (souvent accident vasculaire cérébral périnatal).
- Tétraplégie spastique – les quatre membres et le tronc (plus grave, souvent accompagnée de troubles de la parole et de la déglutition).
- Ce que les familles remarquent en premier : des chaussures usées de manière inégale, une posture sur la pointe des pieds, une main qui s’ouvre difficilement.
2) Dyskinétique (athétosique/dystonique) de la PC – « mouvements qui ne restent pas immobiles »
La « boîte de vitesses » du mouvement (ganglions de la base) a été endommagée, souvent par un kernictère ou de graves problèmes d’oxygénation. Le tonus fluctue ; les mouvements sont tordus, convulsifs ou soudains et peuvent s’aggraver en cas de stress ou d’excitation.
- Comment cela se manifeste : ton variable – tantôt mou, tantôt rigide ; mouvements involontaires de la tête/du cou ; grimaces faciales ; discours difficile à contrôler même lorsque les pensées sont claires.
- Ce que les familles remarquent en premier : l’enfant peut bouger mais ne contrôle pas bien ses mouvements ; il est « mou » comme un bébé, puis « tordu » lorsqu’il fait des efforts.
3) CP de type ataxique – « le système d’équilibre est perturbé »
Le cervelet (le coordinateur du cerveau) est affecté. Les mouvements sont saccadés, le timing est décalé et l’équilibre est fragile.
- Comment cela se manifeste : démarche à base large, tremblements intentionnels (la main tremble lorsqu’elle s’approche d’une cible), difficulté à effectuer des mouvements alternés rapides, élocution indistincte ou saccadée.
- Ce que les familles remarquent en premier : chutes fréquentes, motricité fine « maladroite », écriture qui fatigue rapidement.
4) Formes mixtes de PC – « plusieurs schémas à la fois »
La réalité respecte rarement nos catégories. Un enfant peut souffrir à la fois de spasticité et de dystonie, par exemple. Nous traitons le trouble qui limite le plus les fonctions et nous adaptons le traitement à mesure que l’enfant grandit.
Deux autres lentilles que nous utilisons toujours chez Cerebral Palsy (car elles modifient la planification)
- Répartition : S’agit-il principalement des jambes (diplegie) ? D’un seul côté (hémiplégie) ? Ou des quatre membres et du tronc (quadriplégie) ? La répartition détermine les objectifs, qui vont du port d’orthèses et de l’entraînement à la marche à la thérapie bimanuelle et au positionnement assis.
- Niveau fonctionnel (GMFCS I–V) :
Une échelle pratique allant de « marche sans limitation » (niveau I) à « nécessite un fauteuil roulant pour se déplacer » (niveau V). Il ne s’agit pas d’un verdict, mais d’un outil qui nous aide à fixer des objectifs réalistes et utiles : marcher de manière autonome pour certains, se déplacer en toute sécurité et communiquer pour d’autres.
Où les cellules souches et les exosomes s’inscrivent-ils dans ces types (bref et honnête) ?
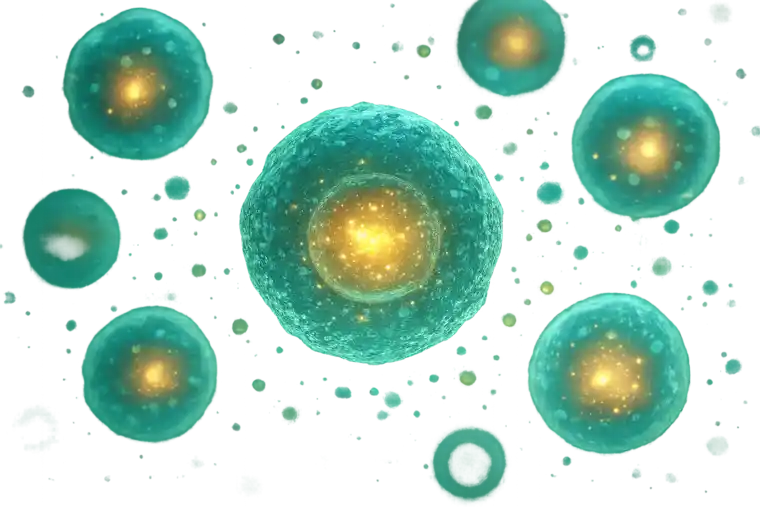
- Dans les schémas spastiques, la réduction de la neuro-inflammation et l’amélioration de la connectivité de la substance blanche peuvent atténuer le tonus et rendre le traitement plus efficace.
- Dans les schémas dyskinétiques, les progrès sont plus lents ; toute amélioration du contrôle du tronc/de la tête ou réduction du débordement facilite la communication et l’alimentation.
- Dans les schémas ataxiques, même de légères améliorations de la signalisation cérébelleuse peuvent se traduire par un équilibre plus stable et une diminution des tremblements à l’effort.
- Dans les modèles mixtes, nous suivons l’objectif fonctionnel, et non l’étiquette : transferts plus faciles, mots plus clairs, déglutition plus sûre, moins de chutes.
Rien de tout cela ne remplace la rééducation des patients atteints de paralysie cérébrale. La thérapie biologique modifie l’environnement ; la rééducation enseigne les compétences. Lorsque les deux s’alignent, nous constatons des progrès qui semblaient hors de portée auparavant.
Symptômes et défis quotidiens liés à la paralysie cérébrale
Les signes les plus visibles de la PC sont d’ordre moteur (difficultés à marcher, maladresse des mains), mais les difficultés cachées sont souvent plus importantes : retard de langage, bave, convulsions, douleur, frustration émotionnelle.
Un de mes jeunes patients atteints de paralysie cérébrale m’a dit un jour, à l’aide d’un tableau de communication : « Mon corps est lent, mais mes pensées sont rapides. » Cette phrase résume mieux la paralysie cérébrale que n’importe quel manuel scolaire.
Thérapie à base de cellules souches pour la paralysie cérébrale – Ce que nous dit la science – Expérience avec de vrais patients
Les cellules souches ne sont pas des cellules magiques ; ce sont des systèmes de soutien. Elles libèrent des facteurs de croissance qui apaisent l’inflammation, protègent les neurones et favorisent la création de nouvelles connexions. La plupart des travaux actuels utilisent des cellules souches mésenchymateuses (CSM) issues de la gelée de Wharton, le tissu mou présent à l’intérieur des cordons ombilicaux donnés après des naissances sans complication.
Au cours de la dernière décennie, la recherche sur la paralysie cérébrale a commencé à rattraper ce que certains d’entre nous ont observé au chevet des patients.
Une étude clinique récente publiée dans la NLM (National Library of Medicine) https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10989435/ a examiné comment les cellules souches issues de la gelée de Wharton, le tissu mou à l’intérieur du cordon ombilical, peuvent aider les enfants atteints de paralysie cérébrale à se déplacer plus librement et à réduire leur spasticité.
Les données sont préliminaires, mais elles vont dans un sens qui me semble juste après des années de travail clinique.
J’ai observé ces petits changements de mes propres yeux.
Une petite fille atteinte de paralysie cérébrale, âgée de sept ans, avait beaucoup de mal à tenir en équilibre lorsqu’elle est arrivée chez nous. Après plusieurs séances combinant des cellules souches de la gelée de Wharton et des exosomes, elle a commencé à faire ses premiers pas, hésitants et instables, mais c’étaient ses propres pas.
Un autre enfant, qui n’avait jamais réussi à former des mots clairs, s’est soudainement mis à nommer des couleurs pendant une séance de thérapie. On pouvait lire l’incrédulité sur le visage de sa mère, un mélange de joie et de larmes.
Ce ne sont pas des miracles, et ce ne sont pas des remèdes.
Mais ce sont des moments qui changent la vie d’une famille, des moments qui rendent l’impossible presque possible.
Et dans notre domaine, cette différence importe davantage que les statistiques ne le feront jamais.
Le parcours du patient dans le traitement par cellules souches et exosomes de la paralysie cérébrale
Le parcours thérapeutique de chaque enfant commence bien avant la première injection. Il commence par une conversation, et non par une liste de contrôle.
Lorsque les familles arrivent, je prends le temps de les écouter. Nous regardons ensemble les IRM, discutons de ce qui a changé et de ce qui n’a pas changé, et surtout, de leurs espoirs. Parfois, ces espoirs sont simples : « Je veux juste que mon enfant puisse s’asseoir sans tomber » ou « qu’il puisse prononcer clairement un mot ». C’est alors notre point de départ.
Une fois que nous avons compris le tableau clinique, nous élaborons un plan adapté à l’enfant, et non l’inverse. Le nombre de séances, la voie d’administration (parfois par voie intraveineuse, parfois dans le liquide céphalo-rachidien), voire les intervalles entre les applications, sont déterminés en fonction des besoins de l’enfant, et non selon une formule standard.
Les cellules elles-mêmes proviennent de cordons ombilicaux donnés après des naissances sans complication. Elles sont préparées dans un laboratoire certifié GMP, puis contrôlées et testées jusqu’à ce que nous soyons absolument certains qu’elles peuvent être utilisées en toute sécurité.
Lorsque le traitement commence, il se déroule dans un environnement médical stérile, sous surveillance attentive. Les parents attendent souvent à proximité, nerveux mais pleins d’espoir. La plupart des enfants tolèrent très bien l’intervention : ils sont un peu somnolents après, mais se rétablissent en quelques heures.
Vient ensuite la partie la plus importante : la rééducation.
La thérapie à base de cellules souches et d’exosomes peut ouvrir la porte, mais c’est la thérapie qui aide l’enfant à la franchir.
Parfois, les premiers changements sont si minimes que seuls les parents les remarquent. Une main qui était toujours crispée commence à se détendre. Les yeux suivent les mouvements plus facilement. Le rire vient plus facilement. J’ai appris que ce sont ces petits moments, plus que n’importe quel résultat de test, qui permettent aux familles de garder espoir.
Je leur dis : « Ne cherchez pas de feux d’artifice, cherchez plutôt de petites lumières qui apparaissent une à une. »
Comprendre les exosomes – Les petits messagers qui changent la donne
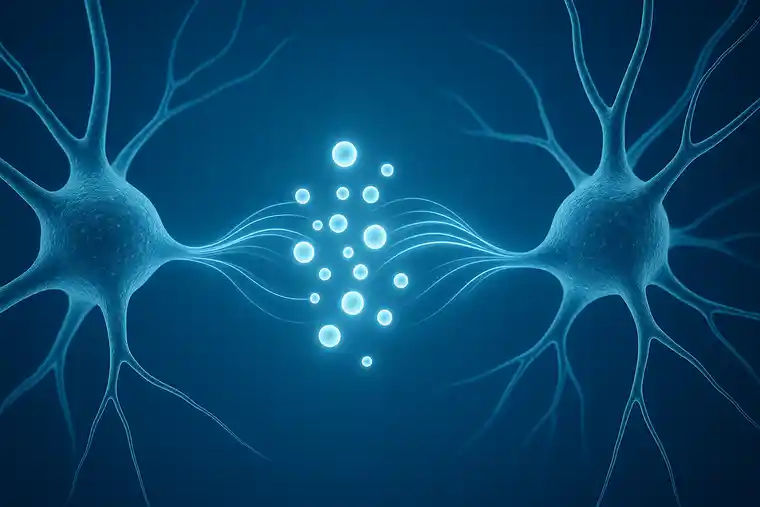
Au fil des années passées à étudier les cellules souches, j’ai commencé à remarquer quelque chose de remarquable : même lorsque les cellules elles-mêmes ne survivaient pas longtemps, les patients voyaient parfois leur état s’améliorer. Cela a soulevé une question importante : qu’est-ce qui provoquait exactement la guérison ?
Parfois, après avoir travaillé pendant des années avec des cellules souches, je me suis demandé pourquoi certains patients voyaient leur état s’améliorer alors même que les cellules elles-mêmes ne survivaient pas longtemps dans l’organisme. Cela m’a amené à penser que ce n’étaient peut-être pas les cellules elles-mêmes qui agissaient directement, mais quelque chose qu’elles émettaient.
Ce « quelque chose » s’est avéré être des exosomes, de minuscules bulles libérées par les cellules vivantes, transportant des instructions chimiques et des fragments de code génétique. Elles voyagent à travers le corps comme des messagers silencieux, aidant une cellule à communiquer avec une autre.
Chez les enfants atteints de paralysie cérébrale, où les lésions sont profondes dans le cerveau et protégées par des barrières que la plupart des traitements ne peuvent franchir, cette communication devient cruciale. Les exosomes sont suffisamment petits pour traverser ces barrières et atteindre les zones qui ont encore le potentiel de réagir.
Le cerveau se protège derrière une barrière appelée barrière hémato-encéphalique, qui empêche la plupart des traitements d’y pénétrer. Les cellules souches sont trop grosses pour la traverser. Les exosomes, en revanche, sont suffisamment petits pour la franchir et atteindre les zones qui ont réellement besoin d’aide.
Une fois arrivées, elles semblent apaiser l’inflammation qui maintient le cerveau dans un état de tension constant. Elles favorisent également la formation de nouveaux vaisseaux sanguins minuscules, ce qui améliore le flux d’oxygène et de nutriments, et peuvent même encourager les fibres nerveuses à se reconnecter, rétablissant ainsi lentement la communication perdue.
Ce qui rend les exosomes si intéressants pour moi en tant que clinicien, c’est leur innocuité. Ils ne se divisent pas, donc ils ne peuvent pas former de tumeurs. Ils peuvent être nettoyés, testés, stockés et utilisés d’une manière qui s’apparente davantage à l’envoi d’un signal biologique qu’à une greffe. Il s’agit encore de travaux préliminaires, mais d’après mon expérience, leur rôle ne fera que se renforcer dans les années à venir.
D’après notre expérience clinique préliminaire, les applications des exosomes se sont révélées sûres et bien tolérées : aucun effet indésirable grave n’a été signalé, seulement une légère fatigue ou des maux de tête passagers.
Sécurité, risques et innovation responsable
Les gens me demandent souvent : « Est-ce sans danger ? » Et je comprends cette question mieux que toute autre. J’ai moi-même des enfants, et je sais ce que cela signifie de confier un être cher à la médecine.
C’est pourquoi je ne recommande jamais aucun traitement à moins d’être à l’aise de le proposer à ma propre famille. La sécurité n’est pas une simple case à cocher, c’est le fondement même de tout ce que nous faisons. Les laboratoires avec lesquels nous travaillons sont certifiés GMP, chaque lot de cellules souches ou d’exosomes est testé pour garantir sa pureté, et chaque patient fait l’objet d’un suivi attentif après chaque séance.
Cependant, toute intervention médicale comporte un certain degré de risque. Avec les traitements régénératifs, nous observons parfois des réactions légères : une légère fièvre, un léger mal de tête ou une fatigue qui disparaît après un jour ou deux.
Mais il existe un autre type de risque : les faux espoirs. Ce domaine évolue rapidement, et j’ai appris à trouver le juste équilibre entre optimisme et honnêteté. Chaque succès nous apprend quelque chose ; chaque revers nous rappelle de rester humbles. Mon objectif n’est pas de remplacer la médecine traditionnelle, mais de la compléter, d’offrir une solution lorsque la rééducation seule a atteint ses limites.
Progrès réalistes en matière de PC – À quoi ressemble réellement le changement ?
Je suis toujours honnête avec les familles quant à ce à quoi elles peuvent s’attendre. Il ne s’agit pas d’un interrupteur qui permet de revenir à la situation antérieure. Le rétablissement est lent, parfois visible, parfois imperceptible.
J’ai vu des mains qui étaient crispées se détendre au fil des semaines de thérapie. J’ai vu des enfants qui évitaient le contact visuel lever soudainement les yeux et soutenir le regard, juste une seconde de plus. Ces secondes comptent. Elles peuvent sembler insignifiantes pour les autres, mais pour un parent, elles représentent tout. Elles sont la preuve que l’histoire n’est pas encore terminée.
Qualité et approvisionnement éthique en cellules souches et exosomes pour la paralysie cérébrale
Tous les matériaux biologiques utilisés dans notre programme proviennent de cordons ombilicaux donnés après des naissances sans complication, avec le consentement total des parents.
Le tissu est traité dans des installations conformes aux bonnes pratiques de fabrication (BPF) et aux réglementations nationales et internationales.
Chaque lot est soumis à un dépistage des infections et à un contrôle de stabilité génétique avant sa mise en circulation.
Pour moi, ce n’est pas un détail technique, c’est une question d’éthique.
On me demande souvent comment nous concilions espoir et science. À vrai dire, ce n’est pas facile. La médecine régénérative se situe dans cet espace étroit entre ce que nous savons et ce que nous pensons être possible un jour. C’est pourquoi je m’en tiens à une règle simple : je ne propose aucune thérapie que je ne voudrais pas pour ma propre famille.
La qualité et la sécurité passent avant tout. Le travail en laboratoire, les tests cellulaires, la sélection des patients : chaque étape doit inspirer confiance. C’est la seule façon pour ce domaine de se développer sans perdre sa crédibilité.
J’ai appris à rester prudemment optimiste. Chaque fois que nous constatons des progrès chez un enfant, nous nous en réjouissons, mais discrètement. Car pour chaque succès, il y a un autre cas qui nous rappelle tout ce que nous ignorons encore. Cette humilité fait partie intégrante de la science.
Notre objectif n’est pas de remplacer la médecine conventionnelle, mais de la compléter. Nous voulons offrir aux familles une issue lorsque toutes les voies habituelles semblent se refermer. Parfois, cela implique un grand pas en avant, parfois seulement un petit pas, mais pour les familles que je rencontre, même un petit pas peut tout changer.
Conclusion – Un espoir fondé sur la science
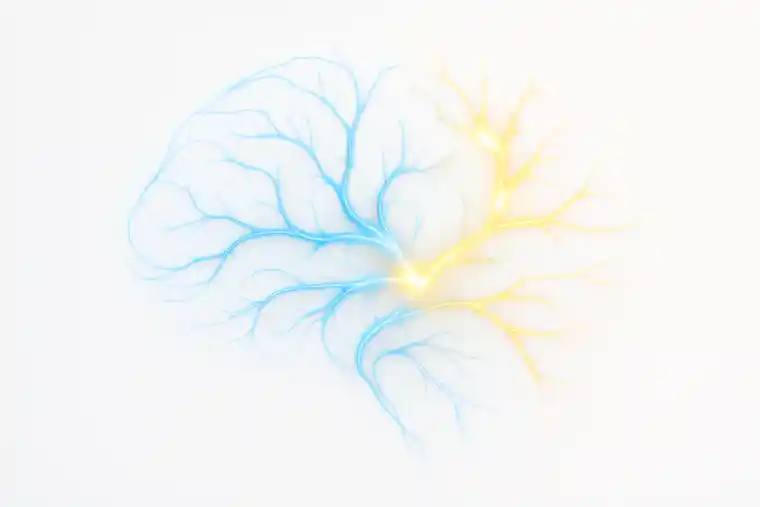
La paralysie cérébrale modifie non seulement le corps de l’enfant, mais aussi le rythme de vie de toute la famille.
Les thérapies à base de cellules souches et d’exosomes pour la PC ne peuvent pas effacer le passé, mais elles peuvent façonner l’avenir.
Ils offrent de nouvelles possibilités : améliorer les mouvements, la parole et la qualité de vie, parfois d’une manière que nous n’aurions pas pu imaginer il y a dix ans.
La médecine, dans son essence même, vise à restaurer la dignité.
Si un enfant peut faire un pas tout seul, prononcer un mot clairement ou sourire sans trop d’effort, c’est une victoire qui vaut la peine d’être poursuivie.
À mesure que la science progresse, je reste guidé par le même principe qui m’animait lorsque j’étais jeune neurochirurgien : donner à chaque patient une chance équitable d’avoir un avenir meilleur.
Foire aux questions sur le traitement par cellules souches et exosomes pour la paralysie cérébrale
Existe-t-il un véritable remède contre la paralysie cérébrale ? Mon enfant pourra-t-il un jour guérir complètement ?
C’est la première question que se posent tous les parents. La réponse honnête est : non, il n’existe pas encore de remède complet.
La lésion cérébrale à l’origine de la paralysie cérébrale ne disparaît pas. Mais cela ne signifie pas que rien ne peut changer. Ce que nous essayons de faire avec la thérapie par cellules souches et exosomes, c’est d’aider le cerveau à mieux fonctionner avec ce qui est encore sain, afin de rendre les mouvements plus fluides, la parole plus claire ou les muscles moins raides. Certains enfants nous surprennent, d’autres se sentent simplement un peu plus à l’aise dans leur corps. Les deux sont importants.
Quelle est la probabilité que mon enfant s’améliore réellement ?
C’est différent pour chaque enfant. Certaines familles remarquent des changements dès la première séance : meilleur contrôle de la tête, plus grande facilité à s’asseoir, meilleure concentration.
Pour d’autres, cela prend des mois, ou les progrès restent très subtils. Ce que nous observons le plus souvent, ce sont de petits gains réels qui facilitent un peu la vie quotidienne.
Il n’y a pas de pourcentage fixe qui convienne à tout le monde. Ce qui importe, c’est que la thérapie, la rééducation et le traitement biologique fonctionnent ensemble. C’est alors que nous commençons à voir des progrès significatifs, même s’ils ne sont pas spectaculaires.
Combien de séances sont généralement nécessaires, et à quels intervalles ?
La plupart des familles commencent par deux ou trois séances, espacées d’une semaine. Cela laisse le temps au corps et au système nerveux de réagir.
Le plan est toujours individuel, basé sur les résultats de l’IRM, l’état de santé et l’efficacité du premier traitement. Nous ne précipitons jamais les choses ; il est plus important de progresser régulièrement et de manière contrôlée que de répéter rapidement les mêmes gestes.
Est-ce sans danger pour les jeunes enfants ?
Oui, lorsqu’elle est pratiquée dans un environnement médical certifié avec des cellules souches et des exosomes provenant de cordons ombilicaux sains et sélectionnés.
Les principaux effets observés sont légers et de courte durée : fatigue, légère fièvre ou maux de tête pendant une journée. Aucune complication grave n’est survenue dans le cadre de notre travail clinique. Le véritable risque réside dans le choix d’une clinique non réglementée qui ne respecte pas les BPF ou l’éthique médicale.
Quand pouvons-nous espérer voir des changements, et à quoi ressembleront-ils ?
En général, pas immédiatement. Les parents remarquent souvent les premiers signes après quelques semaines : une main qui commence à se détendre, un mot plus clair, une meilleure tenue de la tête.
Les progrès se font discrètement, étape par étape, et toujours accompagnés d’une rééducation. Nous disons aux familles : ne cherchez pas de miracles, cherchez plutôt les petites lumières qui apparaissent une à une.
Quelle est la différence entre les cellules souches et les exosomes, et pourquoi utiliser les deux ?
Les cellules souches sont comme les cellules « mères » : elles libèrent des signaux utiles qui apaisent l’inflammation et favorisent la guérison.
Les exosomes sont de minuscules messagers qui transportent ces signaux à travers l’organisme. Ils sont suffisamment petits pour passer à travers des endroits inaccessibles aux cellules souches, même la barrière naturelle qui protège le cerveau.
Lorsque nous les utilisons ensemble, les cellules souches créent le signal de guérison et les exosomes l’acheminent directement là où il peut être le plus utile. Elles fonctionnent comme une équipe : l’une parle, l’autre s’assure que le message arrive à bon port.
Obtenez une consultation gratuite
- Besoin d'être guidé et rassuré ?
- Parlez à une vraie personne de MedClinics !
- Trouvons ensemble le médecin idéal.